Raphaël Quenard n’écrit pas pour plaire. Il écrit pour déranger, explorer. Avec Clamser à Tatatouine, l’acteur à la gouaille particulière propose un roman noir, sale, et excessif, à l’image de ses rôles. Un livre qui divise, qui secoue, mais qui m’a terriblement surprise.
Confession d’un accro mal dans sa peau
Le récit s’ouvre dans un monologue qui fait froid dans le dos, celui d’un personnage dont on ne saura presque rien. Ni nom, ni âge, ni certitude sur ses motivations. Ce narrateur est une ombre dérangée, rongée par une multitude d’addictions, dont l’une sera insatiable : celle du meurtre. Et ce qui commence comme une introspection basculera vite dans une spirale de violence accélérée, crue, plutôt bien décrite. Même si l’auteur glisse vers quelques écueils des premiers romans, il tient très honorablement sa barre.
Dans cette confession dont le rythme, tendu comme un câble, maintient la lecture en tension constante, on tourne les pages, happé entre fascination morbide (j’admets un certain attachement) et révulsion.
« On est aux putes ou chez Bocuse ? »
L’un des coups de force du roman, c’est sa langue. Son écriture est vivante, instable. On retrouve l’argot imagé des cités, le lexique médical, quelques figures poétiques et des traits de génie lexical. Dans les dialogues comme dans les introspections, le choix des mots est réfléchi pour calquer à la situation ou aux personnages (même si quelques fois cela manque de la subtilité du naturel). Le style claque, fait rire, fait mal. Raphaël Quenard signe une profession de foi texto dans les premières pages. « Quand on aime les mots, c’est sans distinction de registre. » Dans un monde qui tend à appauvrir ses langues dans un souci de facilité, on se doit de réemployer l’ensemble de leurs richesses : patois, argots, termes techniques, langages soutenus ou châtiés.
Oui, quelques lourdeurs de style rappellent que c’est un premier roman, mais elles n’entachent en rien la singularité de la plume. Raphaël Quenard écrit comme il parle : avec musicalité organique, insolence et tendresse acide.
Patatra, le public policé ne comprend pas
Les scènes de féminicides ont suscité des critiques virulentes. Certains y ont vu une complaisance, une provocation malsaine. Mais Raphaël Quenard répond avec lucidité : « La moralité n’a pas de place dans l’art », déclarait-il sur France Inter. Un propos qui, s’il dérange, invite à réfléchir sur la représentation du mal dans la fiction.
Le roman ne cherche pas à excuser ou à glorifier. Il dépeint un être en ruine, en quête d’existence, qui ne trouve que dans la transgression une forme de soulagement. C’est brut, parfois insoutenable, mais c’est une littérature qui refuse l’édulcoration, et c’est peut-être ce qui la rend si intéressante. On ne peut pas lire et se projeter uniquement à travers les bons, les justes et les gentils. Qu’on aime ou non ce premier roman, il a le mérite de la créativité libre que l’on cherche (à grands tords) d’atténuer pour ne pas blesser, vexer ou choquer. Bravo, on espère que le prochain sera pire.
Clamser à Tataouine, Raphaël Quenard, éd. Flammarion, 190 p., 22€
En librairie

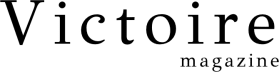





Merci j’ai hâte de lire ce livre.